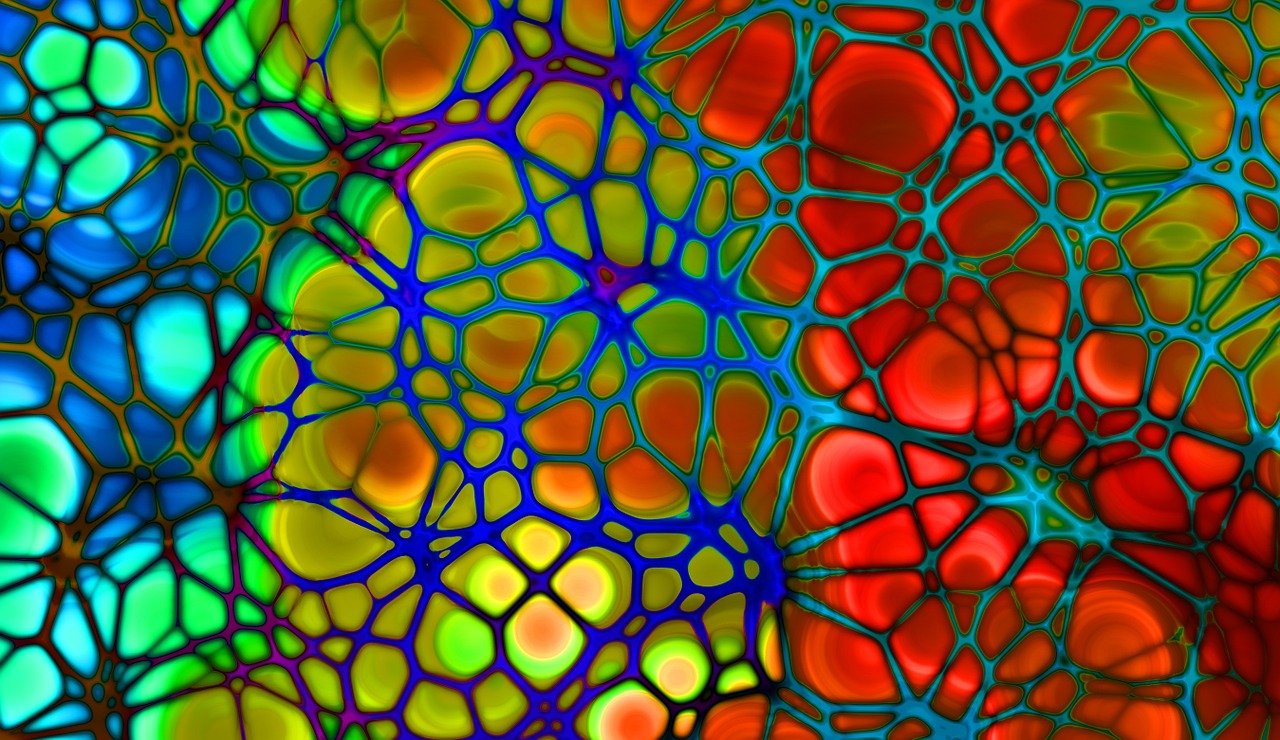Rousseau termine son livre en traitant de ce qu’il appelle la Religion Civile (IV,8). Il y voit une solution à un problème de taille. Rationnellement, logiquement, l’architecture de son édifice politique se tient. Mais revient toujours la question déjà rencontrée : comment gérer les embrouilles des affects ?
« Ainsi le Législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. » (II,7 Du Législateur)
C’est à partir d’un panorama historique qu’il aborde le rapport entre religion et pouvoir politique. Dans les sociétés archaïques, « De cela seul qu’on mettait Dieu à la tête de chaque société politique, il s’ensuivit qu’il y eut autant de Dieux que de peuples (…) Ainsi des divisions nationales résulta le polythéisme, et de là l’intolérance théologique et civile, qui naturellement est la même. »
La naissance du judaïsme monothéiste, sans prétention prosélyte, ne change pas encore la donne. Mais ensuite la prétention universaliste du christianisme va trouver son vecteur dans la structure intégrée de l’empire romain, et aboutir à un nouvel impérialisme « et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l’autre monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci. » Pourris de papistes …
S’ensuit un chapelet de conflits entre nations avec leurs lois civiles, et despotisme papiste prétendant imposer les siennes.
Négligeant avec pragmatisme le point de vue religieux mais aussi moral, Rousseau déplore surtout le facteur d’instabilité politique.
« Tout ce qui rompt l’unité sociale ne vaut rien : toutes les institutions qui mettent l’homme en contradiction avec lui-même ne valent rien. » La question est donc de concilier « la Religion de l’homme et celle du Citoyen ».
« Le droit que le pacte social donne au Souverain ne passe point, comme je l’ai dit, les bornes de l’utilité publique. Les sujets ne doivent donc compte au Souverain de leurs opinions qu’autant que ces opinions importent à la communauté. On doit tolérer toutes (les religions) qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n’ont rien de contraire aux devoirs du Citoyen. »
Le petit Suisse serait-il le promoteur de la laïcité à la française ?
D’une certaine manière, sauf qu’il n’admet pas l’athéisme. Pas le spirituel bien sûr, mais le social. « Il importe bien à l’État que chaque Citoyen ait une Religion qui (se rapporte) à la morale et aux devoirs que celui qui la professe est tenu de remplir envers autrui. » Cette profession de foi purement civile crée et conforte « les sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être bon Citoyen et sujet fidèle. »
Il la veut simple, « divinité bienfaisante et pourvoyante, bonheur des justes, châtiment des méchants, sainteté du Contrat social et des Lois. » Simple, voire enfantine ? On peut le dire sans ironie. JJ fait jouer ici le ressort archaïque de la morale, le plus sûr sans doute : chercher l’amour de bons parents. Ce qui ne marche que si les parents sont effectivement suffisamment bons. Genre État providence (dont le délitement durcit les rapports sociaux, ce n’est plus à démontrer).
« Quant aux dogmes négatifs (ce qu’il faut refuser) je les borne à un seul : l’intolérance. Partout où l’intolérance théologique est admise, il est impossible qu’elle n’ait pas quelque effet civil. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu’on croit damnés. Il faut absolument qu’on les ramène ou qu’on les tourmente. »
L’intolérance, ennemie jurée de la démocratie et de la paix civile, en ce que, même non religieuse, elle a toujours quelque chose de théologique.
Image par Gerd Altmann de Pixabay