Bonjour,
J’aime l’histoire mais je suis nul en histoire. D’ailleurs je ne sais pas si on doit écrire histoire ou Histoire avec un grand H.
Ce matin-là, j’étais simplement allé chercher du pain.
Rien d’historique là-dedans, sauf qu’en sortant de la boulangerie, j’ai levé les yeux : “Moulin Lafayette.”
Le moulin, je comprenais — rapport au pain, à la farine, à la pâte. Mais Lafayette ? Qu’est-ce qu’il venait faire là, entre deux baguettes ?
Je me suis rappelé que j’avais déjà vu ce nom partout : des rues, des lycées, des places, des hôtels, même un centre commercial.
Et plus j’y pensais, plus ça me travaillait. Pourquoi y a-t-il autant de Lafayette ? Pourquoi cette obsession collective pour un nom que la plupart d’entre nous ne connaît qu’à moitié ?
Alors j’ai fait ce que je fais souvent quand un détail anodin commence à m’obséder : j’ai cherché.
Et, très vite, je me suis rappelé que j’étais nul en histoire.
Mais en creusant un peu — peut-être trop — j’ai fini par comprendre que ce n’était pas Lafayette qui m’intéressait vraiment, c’était ce qu’il représente : la manière dont certaines figures traversent le temps intactes, pendant que d’autres s’effacent dans le silence.
Et là, tout s’est mis à s’imbriquer.
Les statues, les noms de rues, les manuels, les récits… tout un système d’hommages qui, sous prétexte de mémoire, fabrique de l’amnésie. Lafayette n’est pas seulement un personnage : c’est une méthode. Celle qui consiste à transformer l’histoire en vitrine, à blanchir les contradictions pour rendre la liberté présentable.
Avis aux historiens et aficionados d’encyclopédie en 30 volumes, l’article n’est qu’un axe de réflexion subjectif et une compréhension de mes lectures. Ne me lapidez pas, je vous rappelle que je suis nul en histoire.
Bisous.
ps : Les viennoiseries étaient délicieuses.
Le héros qui ne risquait rien
Dans chaque musée d’histoire occidentale, il y a un visage qui revient, lisse, rassurant : celui du marquis de Lafayette.
Un jeune noble à la mise impeccable, présenté comme le chaînon parfait entre la France des Lumières et la jeune Amérique en quête d’indépendance.
Le “héros des deux mondes”, symbole d’une liberté universelle et d’un humanisme précoce.
Mais il faut oser gratter le vernis : Lafayette est d’abord un aristocrate qui n’a jamais risqué ce que la liberté coûte vraiment. Il incarne une révolution sans douleur, une rébellion sous contrôle, celle des salons et des correspondances, pas des faubourgs.
Lafayette n’a jamais été l’homme du peuple : il a été l’homme que le peuple pouvait admirer sans effrayer ses maîtres. En ce sens, il est le prototype du héros acceptable : blanc, riche, cultivé, et, surtout, capable de raconter sa propre histoire avant que d’autres ne la lui écrivent. Sa légende s’est construite dans la langue des vainqueurs, celle qui gomme les bruits, les corps, et les contradictions.
Deux siècles plus tard, son héritage ne se limite plus à un nom gravé sur des avenues : il est devenu un modèle de blanchiment narratif. De Washington à Paris, de la statue au manuel scolaire, Lafayette symbolise ce qu’une société aime retenir d’elle-même : le courage, sans la boue ; la liberté, sans la révolte.
Lafayette a vingt ans quand il embarque pour l’Amérique en 1777. Pas par famine, pas par désespoir, mais par idéalisme et ambition. Il est jeune, immensément riche, marié à Adrienne de Noailles, issue d’une des familles les plus puissantes de France. Il s’achète un navire, La Victoire, et traverse l’Atlantique pour se battre aux côtés de Washington. Ce geste romantique est souvent raconté comme une preuve de bravoure désintéressée — mais c’est d’abord un pari symbolique, celui d’un homme qui veut se tailler un rôle dans la grande fresque de l’Histoire.
En Amérique, il devient l’ami de Washington, l’enfant chéri des révolutionnaires. Son courage sur le champ de bataille est réel, mais son image publique l’est encore plus. Il comprend très vite que la gloire moderne ne se gagne plus seulement avec des épées : elle se construit avec des lettres, des portraits et des récits. Lafayette se met donc à documenter sa propre légende, à correspondre avec les intellectuels des deux continents, à modeler sa réputation d’intermédiaire éclairé entre le vieux monde et le nouveau.
Quand il rentre en France, il ramène avec lui un capital symbolique énorme. Dans une société où la noblesse tremble encore sous le poids de ses privilèges, Lafayette se présente comme un pont : un noble du peuple, un révolutionnaire civilisé. Il réclame la liberté, mais une liberté sous conditions. Une monarchie constitutionnelle, pas l’égalité réelle.
Puis vient le Champ-de-Mars, 17 juillet 1791. Le peuple réclame la déchéance du roi. Lafayette, à la tête de la Garde nationale, ordonne de tirer sur les manifestants. On comptera plusieurs dizaines de morts. Ce jour-là, le héros de la liberté choisit l’ordre sur la justice. Et pourtant, la mémoire collective lui pardonnera tout.
Pourquoi ? Parce qu’il représentait la liberté qui ne menace pas les puissants. Celle qu’on peut célébrer sur des timbres sans rougir. Celle qui garde la forme d’un idéal, pas d’une insurrection.
Lafayette a survécu à tous ses échecs, à toutes ses contradictions, parce qu’il appartenait à la classe qui écrit les récits.
Son visage est resté dans les manuels, quand ceux de Jacques Roux, de Claire Lacombe ou de Sanité Bélair ont disparu dans les marges. La liberté, quand elle est aristocratique, laisse des statues. Quand elle vient d’en bas, elle laisse des trous dans les archives.
Les oubliés du peuple, ceux qu’on n’a pas sculptés
L’Histoire adore les héros qui se lavent les mains avant d’écrire leurs mémoires. Les autres, ceux qui ont les doigts pleins de terre, disparaissent vite. Pourtant, c’est chez eux que la liberté s’est vraiment incarnée.
Prenons Jacques Roux, prêtre défroqué, figure des sans-culottes. Il ne voulait pas seulement la chute d’un roi, mais celle d’un système. Dans son célèbre Manifeste des Enragés, il accuse la bourgeoisie révolutionnaire d’avoir trahi le peuple. “Vous avez remplacé les nobles par des riches.” Robespierre le fait arrêter. Il se tranche la gorge en prison avant son procès. La République naissante, déjà, tue ceux qui la poussent trop loin.
Ou Claire Lacombe, actrice populaire devenue combattante. Avec Pauline Léon, elle fonde la Société des Républicaines Révolutionnaires, première organisation féministe armée de l’histoire. Elle demande que les femmes puissent voter, combattre, décider. Les Jacobins la feront enfermer pour “excès de virulence”. On ne lui pardonnera jamais d’avoir voulu l’égalité à la place de la galanterie.
Plus loin, sur une autre île, un autre monde : Sanité Bélair, lieutenant dans l’armée de Toussaint Louverture, lutte contre les troupes françaises venues rétablir l’esclavage. Capturée, condamnée, elle refuse le bandeau qu’on lui tend. Elle meurt debout, les yeux ouverts, fusil levé. En France, son nom ne figure dans aucun manuel scolaire.
Ces figures, et tant d’autres, n’ont pas été effacées par hasard. Elles rappelaient que la liberté n’était pas un concept, mais un prix à payer — souvent en sang, souvent sans témoin. Lafayette a incarné la version racontable de la liberté ; eux, la version vécue.
La différence entre les deux tient à un détail essentiel : l’accès à la narration. Lafayette écrivait ses lettres, son image, son histoire. Les autres parlaient dans le vent, ou dans la langue de leurs bourreaux. L’un a eu des chroniqueurs, les autres des juges. L’un a laissé des bustes, les autres des cicatrices.
Et c’est là que commence le véritable blanchiment : celui de la mémoire. Effacer le désordre, la sueur, la rage, pour ne garder que la pose héroïque.

Louis XVI au pied de l’échafaud. En bas à gauche Jacques Roux rédigeant le compte rendu de l’exécution
Des États-Unis à l’amnésie la réécriture de l’histoire comme politique publique
Deux siècles après Lafayette, les États-Unis ont perfectionné ce qu’il avait initié : le récit de la liberté contrôlée. La même mécanique s’y reproduit, plus raffinée, plus méthodique — celle d’un pays qui réécrit son histoire en temps réel pour préserver une illusion de cohérence morale.
En 2020, le projet 1619, initié par The New York Times, proposait une réinterprétation fondamentale : replacer l’esclavage au cœur de la fondation américaine. La réaction fut immédiate et violente. L’administration Trump lança sa contre-offensive : la 1776 Commission, destinée à “rétablir l’histoire patriotique”. L’objectif affiché : empêcher que l’enseignement de l’histoire des États-Unis soit “corrompu par l’idéologie anti-américaine”. Derrière cette rhétorique, on retrouve la même stratégie que dans la légende de Lafayette : contrôler le récit pour éviter que la liberté ne révèle son prix.
Depuis, les législations se sont multipliées. En Floride, le Stop WOKE Act interdit d’enseigner des notions jugées “divisives”, notamment celles qui abordent le racisme systémique. Au Texas, plusieurs districts scolaires ont supprimé des manuels ou réécrit des passages mentionnant l’esclavage et la ségrégation. Des associations comme Moms for Liberty mènent des campagnes actives pour bannir des bibliothèques scolaires des centaines de livres — Toni Morrison, Angie Thomas, Maya Angelou.
Même la description de l’esclavage se transforme.
En 2023, de nouveaux programmes d’histoire de Floride décrivaient les esclaves comme ayant “acquis des compétences utiles” pendant leur servitude. Cette formulation — “useful skills” — n’est pas une maladresse : c’est une stratégie de blanchiment. Transformer une tragédie structurelle en expérience pédagogique.
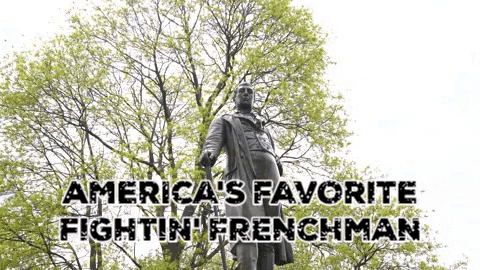 Les manuels scolaires deviennent ainsi les nouveaux champs de bataille idéologique. Derrière le vernis pédagogique, c’est une guerre de mots. On ne dit plus “massacre”, on dit “incident”. On ne dit plus “colonisation”, mais “évangélisation”. Le lexique est la première arme du pouvoir, et Lafayette l’avait compris avant tout le monde : changer la narration, c’est domestiquer la mémoire.
Les manuels scolaires deviennent ainsi les nouveaux champs de bataille idéologique. Derrière le vernis pédagogique, c’est une guerre de mots. On ne dit plus “massacre”, on dit “incident”. On ne dit plus “colonisation”, mais “évangélisation”. Le lexique est la première arme du pouvoir, et Lafayette l’avait compris avant tout le monde : changer la narration, c’est domestiquer la mémoire.
Aux États-Unis, les statues de généraux confédérés tombent lentement, mais les statues mentales, elles, restent debout. Elles sont réécrites dans les curriculums, les séries, les campagnes électorales. La liberté américaine s’entretient comme une marque : on la nettoie, on la polit, on évite qu’elle sente la poudre.
Ce n’est plus de l’histoire, c’est du marketing mémoriel. Et comme toute marque, elle a besoin d’un storytelling simple, lisse, rassurant…à la Lafayette.
Les nouveaux scribes : algorithmes, IA et contrôle narratif
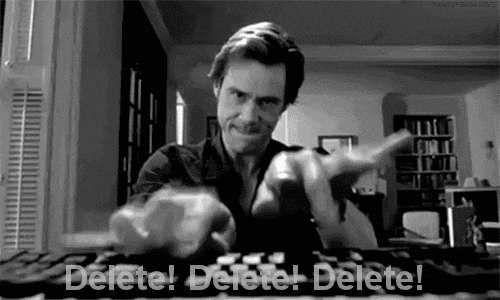 Lafayette avait ses imprimeurs, ses salons, ses correspondances. Nous avons nos serveurs.
Lafayette avait ses imprimeurs, ses salons, ses correspondances. Nous avons nos serveurs.
Ce qui a changé, ce n’est pas la volonté de contrôler la mémoire, mais la vitesse à laquelle on peut le faire.
Les plateformes numériques — YouTube, X, TikTok, Meta — sont devenues les nouveaux champs de bataille mémoriels. Les algorithmes de recommandation décident ce que nous “retenons” de l’époque, tout comme les académies d’hier décidaient ce qui valait d’être enseigné. Ce qui choque, sature, divise ou distrait, remonte. Ce qui questionne, nuance ou creuse, disparaît. L’amnésie collective est devenue un effet secondaire de l’optimisation publicitaire.
Chaque plateforme a désormais son Lafayette : une figure ou une narration calibrée pour maintenir l’ordre du flux. Le contenu qui résiste à cette logique — une archive, un discours subversif, une image trop violente, une vérité embarrassante — est filtré, déréférencé ou “shadowbanné”. L’histoire se réécrit dans les silences que produit la machine.
Les intelligences artificielles génératives participent de cette même dynamique. En réassemblant des fragments d’archives et de récits dominants, elles fabriquent une version moyenne du monde — propre, neutre, lissée. Une sorte de Lafayette algorithmique : toujours poli, jamais dangereux.
Dans quelques années, les modèles d’IA ne seront plus seulement des outils : ils seront des régulateurs culturels. Ils choisiront, consciemment ou non, ce qui mérite d’exister dans le langage.
Et ce n’est pas un hasard si les gouvernements s’y intéressent.
Sous prétexte de sécurité, de moralité ou de lutte contre la désinformation, la régulation algorithmique devient un instrument politique.
En Europe, la proposition Chat Control va plus loin encore : scanner automatiquement les communications privées pour détecter des contenus illicites. L’intention affichée « protéger les enfants » est moralement inattaquable. Mais le résultat est limpide : la normalisation d’un panoptique numérique.
Quand chaque message, chaque image, chaque émotion peut être scrutée par un système d’État, la frontière entre sécurité et censure s’évapore.
C’est une réédition moderne du réflexe Lafayette : surveiller le peuple au nom de sa propre liberté.
Ce qui se joue, ici, n’est plus la bataille du savoir, mais celle de la mémoire immédiate.

L’hypocrisie universelle : ONU, Nobel et blanchisserie morale ?
Quand l’histoire nationale ne suffit plus à anesthésier les consciences, le système délègue la tâche à ses grandes institutions : l’ONU, les prix Nobel, les forums économiques mondiaux. Elles sont les nouveaux temples de la vertu universelle, et comme Lafayette, elles pratiquent un art ancien : rendre la violence présentable.
L’Organisation des Nations Unies, née des ruines de la Seconde Guerre mondiale, a fait de la paix un langage diplomatique et du silence une politique.
De Rwanda en Srebrenica, de Haïti à Gaza, elle a perfectionné l’équilibre entre indignation et inaction.
Chaque fois, les rapports s’accumulent, les résolutions se bloquent, les veto s’alignent. Le Conseil de sécurité n’est plus une instance de justice : c’est une scène de théâtre où les puissants se renvoient la morale à coups de virgules diplomatiques.
La même structure hiérarchique que celle qui a permis à Lafayette de devenir “héros des deux mondes” : quelques-uns décident ce que la liberté doit signifier pour tous.
Quant au prix Nobel de la Paix, il fonctionne comme un miroir poli du pouvoir. Les exemples abondent :
-
Henry Kissinger, récompensé en 1973 pour avoir “mis fin à la guerre du Vietnam” — alors qu’il en avait prolongé les bombardements secrets.
-
Aung San Suu Kyi, autrefois icône démocratique, devenue complice du nettoyage ethnique des Rohingyas.
-
Abiy Ahmed, célébré pour avoir pacifié la Corne de l’Afrique, avant d’y rallumer la guerre au Tigré.
-
Et même Barack Obama, honoré avant d’avoir eu le temps d’agir parce qu’il incarnait, comme Lafayette, une idée plus qu’une réalité.
Chaque prix, chaque discours, chaque drapeau planté au nom de la paix participe du même rituel : blanchir la responsabilité à coups de symboles.
On distribue des récompenses pour ne pas avoir à distribuer la justice.
Ces icônes globales rejouent le rôle de Lafayette à l’échelle planétaire : des figures propres, rassurantes, qui permettent aux institutions de se croire du bon côté de l’histoire tout en perpétuant les structures qu’elles prétendent réguler.
La liberté, la paix, la dignité humaine deviennent des marques déposées, gérées par des conseils d’administration.
Et pendant ce temps, ceux qui dénoncent le mensonge — journalistes emprisonnés, lanceurs d’alerte, peuples affamés — restent les oubliés du récit.
Leur courage n’est pas rentable. Leur mémoire, ingérable.
La liberté sous contrôle
Lafayette n’a pas seulement été un homme de son siècle : il a été un prototype. Celui du révolutionnaire acceptable, du héros calibré pour survivre à sa propre époque. Il a prouvé qu’on peut se battre pour la liberté sans jamais remettre en cause l’ordre, et qu’il suffit de raconter son histoire le premier pour la posséder.
Ce modèle n’a jamais disparu.
Il s’est étendu à la mémoire américaine, puis mondiale : on célèbre l’idée de liberté comme on célèbre une marque, avec ses slogans, ses filtres et ses ambassadeurs. On gomme les contradictions, on blanchit les crimes, on sélectionne les voix. La mémoire collective est devenue une entreprise de design moral.
Aujourd’hui, la technologie ne fait qu’industrialiser ce que Lafayette avait intuitivement compris : la liberté se fabrique par le récit.
Les algorithmes, les IA génératives, les programmes de surveillance comme Chat Control ne sont que les nouveaux instruments de ce vieux pouvoir. On ne brûle plus les livres ; on réécrit les archives à la vitesse du processeur. On ne censure plus par décret ; on ajuste les paramètres du modèle.
Le résultat est plus propre, plus efficace et plus dangereux.
Car ce n’est plus seulement l’histoire qu’on blanchit, c’est la mémoire immédiate. Ce que nous voyons, ce que nous croyons, ce que nous disons, tout devient matière à filtrage.
La légende de Lafayette vit encore dans chaque phrase calibrée, dans chaque vérité optimisée pour ne heurter personne.
Lafayette voulait “guider le peuple sans qu’il s’égare”. Les institutions modernes, les États, les plateformes, poursuivent la même promesse. Le contrôle s’exerce toujours au nom du bien, de la sécurité, de la morale.
Mais l’histoire le prouve : quand on prétend protéger le peuple de lui-même, on prépare toujours sa servitude.
Alors, si Lafayette fut le premier à blanchir la liberté, nous sommes ceux qui blanchissent la mémoire.
Et le jour où la mémoire blanchie deviendra la seule que nous connaissions, il ne restera plus qu’une illusion : celle d’un monde libre qui s’auto-surveille pour mieux se croire vertueux.
Maintenant, vous savez.
📚 Bibliographie et sources
I. Sur Lafayette et la fabrication du mythe
-
Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, Mémoires, correspondance et manuscrits (Paris, H. Fournier, 1837).
-
Lloyd S. Kramer, Lafayette in Two Worlds: Public Cultures and Personal Identities in an Age of Revolutions (University of North Carolina Press, 1996).
-
François Furet, Penser la Révolution française (Gallimard, 1978).
-
Patrice Higonnet, Goodness Beyond Virtue: Jacobins During the French Revolution (Harvard University Press, 1998).
-
Sophie Wahnich, La Liberté ou la mort. Essai sur la Terreur et le terrorisme (La Fabrique, 2003).
-
American Friends of Lafayette, archives et correspondances : https://friendsoflafayette.org/
-
Library of Congress, Lafayette Papers : https://www.loc.gov/collections/marquis-de-lafayette-papers/
II. Figures oubliées et mémoire populaire
-
Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History (Beacon Press, 1995).
-
Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses : les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française (Albin Michel, 1988).
-
Carolyn Fick, The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below (University of Tennessee Press, 1990).
-
Laurent Dubois, Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution (Harvard University Press, 2004).
-
Archives nationales d’Haïti, Dossier Sanité Bélair (consultable via Bibliothèque Haïtienne des Frères de l’Instruction Chrétienne, Port-au-Prince).
III. États-Unis et réécriture historique contemporaine
-
The 1619 Project, The New York Times Magazine, 2019–2021 : https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-slavery.html
-
The President’s Advisory 1776 Commission Report, Maison-Blanche, janvier 2021 : https://trumpwhitehouse.archives.gov/1776-commission/
-
Florida Senate Bill 148 – “Stop WOKE Act” (2022) : https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2022/148
-
PEN America, Banned in the USA: State Laws Supercharge Book Suppression in Schools, 2023 : https://pen.org/report/banned-usa-2023/
-
Reuters, “Florida curriculum says enslaved people benefited from skills training”, 2023.
-
The Washington Post, “Texas education board debates how to teach slavery”, 2022.
IV. Technologie, IA et contrôle narratif
-
Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism (PublicAffairs, 2019).
-
Safiya Umoja Noble, Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism (NYU Press, 2018).
-
European Commission Proposal for Regulation on Child Sexual Abuse Material Detection (Chat Control), 2022 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0209
-
EDRi (European Digital Rights), Chat Control: Why the EU’s Mass Scanning Proposal Threatens Privacy, 2023 : https://edri.org/our-work/chatcontrol-analysis/
-
Reporters Without Borders, AI and the future of censorship, 2024 : https://rsf.org/en/ai-and-censorship
V. ONU, Nobel et blanchisserie morale
-
Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide (HarperCollins, 2002).
-
United Nations Reports on Rwanda (1999) and Srebrenica (1999) : archives officielles de l’ONU.
-
UN Independent Experts Report on Cholera in Haiti, 2016 : https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-12-01/secretary-general%E2%80%99s-remarks-launch-new-approach-cholera-haiti
-
Nobel Prize Archives, notices biographiques :
-
Arundhati Roy, The Algebra of Infinite Justice (2001).
VI. Références théoriques transversales
-
Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme (1951).
-
Edward W. Said, Culture and Imperialism (1993).
-
Achille Mbembe, Critique de la raison nègre (La Découverte, 2013).
-
Byung-Chul Han, La Société de la transparence (PUF, 2014).
-
Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le XXIe siècle (Albin Michel, 2018).


