des natures vivantes ou le parti pris de la vie
(extrait)
La nature des transpoèmes est une « chose naturelle » mais pas une nature morte. Giorgio Vasari parle encore de « cose naturali » pour désigner les motifs peints de Giovanni da Udine, mais bientôt ces termes allaient désigner moins une nature particulière qu’une façon de la représenter selon certains préceptes de l’art. Ce sont les modalités de l’imitation de la nature bien davantage que la nature elle-même qui étaient importants ici. La nature devenue motif. Un passage obligé. Tandis que le XVIIe utilise souvent l’objet naturel comme objet symbolique, le XVIIIe norme autrement ces représentations qui deviennent synonymes d’intérieur bourgeois : ces « natures inanimées » comme les nomme Diderot dans ses Salons sont la nature disciplinée d’un monde bourgeois qui cherche sa représentation, tandis que les peintres comme Chardin y trouvent des objets qui leur permettent de capter la lumière, de travailler la transparence ou la pénombre : le gibier, les fruits ou l’eau sont des éléments constitutifs d’organisations picturales de plus en plus ambitieuses. Le peintre qui vivait dans un pays recouvert de grandes forêts ne ressentait pas l’urgence esth-éthique d’entendre la nature vivante sous l’animal, le fruit ou l’eau.
En marchant à travers champs près de Saint-Jean dans le Cotentin début avril 2019, je n’avais pas pensé que je croiserais un cheval. Mais alors que j’allais enregistrer un poème près d’une barrière, un cheval est venu me rejoindre. Un texte écrit dans une langue fait toujours déjà signe vers d’autres langues et est déjà traduction ; le poème fait aussi déjà signe vers ses contextes de lecture multiples. Un poème est déjà transpoème. Il est cette pluralité agissante. Je n’écris pas à l’époque de Chardin ni de Diderot. Je ne suis adossée à aucune nature luxuriante. Je vis à une époque où la nature est aussi polluée à la campagne qu’en ville et où les insectes meurent en masse. La nature parle à voix basse et menacée. La nature encore vivante bien que menacée de toutes parts, demande à respirer dans le poème.
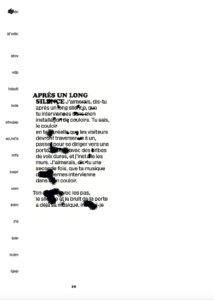
J’enregistre une nouvelle fois le fragment « installation de couloirs ». Sans m’en apercevoir, j’écoute la respiration du cheval en lisant, le timbre de ma voix se transforme et ma respiration se cale sur les pauses de l’animal, créant une autre ponctuation dans le poème. Je croise le regard du cheval, nous nous envisageons. Le « tu » à qui s’adresse le poème devient l’animal qui me regarde. Un autre poème « les boulots pèlent », tiré de « la forêt blanche », évoque un mouvement philanthropique dans une clairière et commence par « presque rien d’un visage ». Le cheval présent qui souffle dans le micro était cette clairière qui permet le surgissement d’une autre langue, d’une voix entre les souffles.
J’ai toujours regretté au cinéma que les cinéastes soient absolument rivés à leurs personnages et n’osent pas leur faire quitter longtemps le champ. Certains, comme Wim Wenders ou Jim Jarmusch les font néanmoins passer hors-champ et disparaître un moment. Dans Mystery Train, la caméra suit les protagonistes puis continue son travelling sans eux, la ville regarde soudain l’écran sans le filtre du personnage. Le spectateur respire, libéré de la présence humaine.
Les « transpoèmes nature » sont une respiration, où les sujets ont quitté presque totalement le champ sonore. On en arrive à souhaiter n’entendre plus que la voix du poème et le chant de la forêt. On perçoit différents plans de silence dans les frondaisons, brièvement interrompus par un aboiement ou un éclat de voix. Un soir à Cassis, le fragment tiré de la « forêt blanche » respire autrement ; la marée haute ou basse dans la Manche et l’étendue de la plage laisse aussi ses empreintes sonores. Alors la phrase « et je souris dans la clairière » déploie pleinement son sens.
Les transpoèmes accueillent les « brins » de cette nature vivante, les brins sonores de cette « pelote inextricable » qu’évoque Jean-Christophe Bailly dans Le parti pris des animaux : (le vivant) « (…) est là sans cesse (…) en nous comme hors de nous, dévidant sans fin et peut-être sans plan le fil de son intelligibilité, celle-ci formant la pelote inextricable dont notre intelligence n’extrait que des brins – tels ces sons ou ces vibrations parvenant dans les chambres rares (…) » (Jean-Christophe Bailly, Le parti pris des animaux, Paris, Christian Bourgeois, 2013, p. 68).
Une discrète polyphonie. Vivante.
Installation de couloirs
.
.
« J’aimerais, dis-tu après un long silence, que tu interviennes dans mon installation de couloirs.
Tu sais, le couloir en taille réelle que les visiteurs devront traverser un à un, passer pour se diriger vers une porte sombre avec des bribes de voix dures, et j’installe les murs. J’aimerais, dis-tu une seconde fois, que ta musique des cavernes intervienne dans mon couloir.
Ton couloir avec les pas, le silence et le bruit de la porte a déjà sa musique, insistai-je. »
.

